
Le nouveau livre de Guillaume de Fonclare «Ce nom qu’à Dieu ils donnent» s’annonce comme «un récit simple et bouleversant […] à la recherche du divin». De quoi s’agit-il? L’auteur avoue avoir commencé ce voyage «comme un aventurier » et l’avoir fini «à la manière d’un pèlerin». Vaste programme pour un itinéraire dont la feuille de route est submergée par l’insaisissable et l’inattendu, surtout quand l’enjeu est de taille et conduit ni plus ni moins vers «le don sublime de retrouver la foi».
L’incipit de votre livre met en exergue de manière douloureuse la perte de la foi de votre jeunesse, ce qui vous a conduit à « tourner en rond […] sur des problématiques sans solution ». Comment vit-on de ce maigre réconfort « à se donner bonne conscience », phénomène si répandu à travers l’histoire de l’humanité?
On se rassure en se donnant l’alibi d’être un homme de raison, de n’être mû que par un esprit que l’on voudrait cartésien, sans vraiment comprendre ce que cela veut vraiment dire. On avance en se cognant aux murs, en trébuchant sans cesse et en maudissant un sort auquel, pourtant, l’on ne croit pas. Je n’étais pas quelqu’un de particulièrement mauvais, mais livré à des passions tristes : l’argent, le pouvoir sur les autres, la réussite sociale et professionnelle, autant de veaux d’or auxquels j’avais dédié ma vie sans comprendre que vivre, ce n’est pas cela.
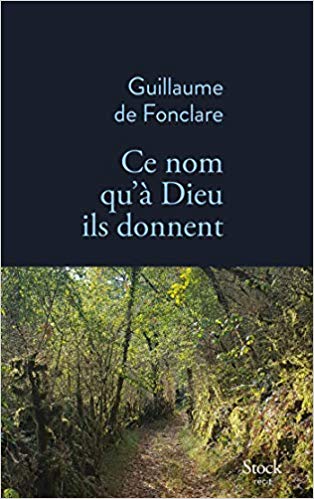
Que faut-il pour qu’un beau jour jaillisse en chacun de nous la question de l’existence de Dieu et comment réussit-on à amarrer à son quotidien «la grande machine des pourquoi», comme vous l’appelez?
Je crois qu’elle est consubstantielle à l’être humain, et que, quelle que soit notre condition, elle vient occuper un jour le murmure de notre esprit. Il suffit parfois d’une épreuve, un deuil, la perte d’un ami ou d’un proche, et la grande machine aux questions se met alors en branle. Ce sont des questions souvent simples, naïves, qui n’ont pas de réponses toutes faites, des questions faites d’espoirs et quelquefois d’optimisme, ou bien à contrario, qui nous entraîne au fond du trou, à craindre de ne plus être et de se perdre dans le grand vide des «pourquoi». Elles apparaissent à tous les âges de la vie, mais d’abord dans l’enfance, lorsqu’on prend conscience, soudain, de l’espace-temps d’une existence ; comment accepter de ne plus être, alors qu’on commence seulement son chemin ? Je me souviens de mon désarroi quand, à l’âge de sept ou huit ans, j’ai pris conscience que le Dieu que l’on me présentait au catéchisme, avec sa longue barbe blanche et ses préceptes moraux, ne résistait pas à une analyse rationnelle des choses. J’ai compris ce que le mot de «croire» sous-entendait d’abandon et de confiance, et je n’étais pas prêt.
«Pour atteindre Dieu, il faut savoir se taire», écrivez-vous. Est-ce la première leçon à retenir de votre expérience ? C’est d’ailleurs ce que vous faites en décidant de passer du temps dans un petit village sur les hauteurs du Quercy.
Je suis d’origine méridionale, et l’apprentissage du silence a été l’un des combats de ma vie. Je dis combat, car je considère qu’il y a une qualité de présence au réel dans le silence que l’on ne retrouve pas forcément dans l’échange et le dialogue, qui ont tout deux leurs vertus, mais pas pour envisager Dieu. Retrouver le calme, et une forme de solitude pour envisager le divin me paraît primordial, car c’est d’abord à soi-même qu’il faut accéder, à ce doux murmure des pensées qui, sans cesse, submerge la conscience et qu’il faut savoir apprivoiser pour atteindre l’essentiel. Savoir accepter ce torrent d’images et d’émotions comme inhérent à la vie humaine, pour pouvoir en domestiquer le cours et retrouver une forme de quiétude plus à même pour se poser les bonnes questions, et pourquoi pas, trouver les réponses adaptées.
Une nouvelle difficulté intervient dans votre quête : comment consentir à l’image d’un Dieu qui accepte «les querelles dévastatrices» d’une humanité qui ne cesse de s’entre-déchirer. «Il m’en faut plus pour m’en convaincre», dites-vous. Quoi de plus ? La rationalité dont vous dites qu’elle fait «un bouclier robuste à tous les assauts de [vos] doutes»?
Pendant longtemps, oui, elle m’a suffi. Je ne comprenais pas que Dieu, omnipotent par nature et ainsi que l’on me l’enseignait dans mes cours d’études bibliques à l’Église protestante, puisse se satisfaire de l’état du monde, même si nous sommes pour bonne part à l’origine de nos tourments. Je rêvais d’un Dieu arbitre des querelles humaines, qui nous aurait remis au pas et qui aurait instauré sur terre un royaume de justice et de paix. C’est une vision très naïve, j’en conviens, et sans doute que d’autres motivations régissent l’organisation du monde. Lorsque j’ai perdu la foi, je me suis raccroché de toutes mes forces à ce que je désignais sous le vocable facile de Raison, ce qui ne m’empêchait pas d’être un brin superstitieux et effrayé par les phénomènes paranormaux. Tout l’être humain est dans ce paradoxe, je crois, se raccrocher aux constructions de l’esprit en oubliant que les forces de la Nature sont toujours à l’œuvre, et que nous n’en comprenons pas toutes les expressions.
La beauté qui vous entoure, la solitude, la musique, la méditation, les promenades sur les causses ont un effet bénéfique dans votre recherche. Ne disent-elles pas aujourd’hui toutes ces paroles la même chose que Paul de Tarse devant l’Aréopage : «Ce que vous adorez sans le connaître, moi je vous l’annonce» ?
Oui, elles forment la face visible du divin dans la vie de l’homme, même si l’homme n’en a pas toujours conscience. Tous ces instants de grâce qui constellent nos vies, prendre une heure pour marcher en forêt, écouter un morceau de musique, s’extasier devant une toile d’un grand maître, ou bien encore, prendre une demi-heure pour méditer ou prendre du temps pour soi, activités que l’on penserait éminemment humaines, je les crois miroirs de Dieu. Je pense qu’il y a des parcelles de divin en chacun de nous, et que la musique, une promenade sur les causses, la méditation nous permettent de nous reconnecter à cette part invisible de nous-mêmes.
Il y a sans doute une étape essentielle que vous franchissez : c’est celle de passer de «Dieu existe-t-Il ?» à «Dieu existes-Tu ?». Il y a une différence ? Laquelle ? Celle de piocher «dans la bonne poche», comme vous le recommande un de vos amis ?
Se poser la question de «Dieu existes-Tu», c’est incarner la problématique, c’est faire de Dieu un être agissant ; je ne suis plus, dès lors, dans le questionnement vain et stérile du «Dieu existe-t-Il», ou la question s’envisage à la manière d’un scientifique qui poserait ses hypothèses. Le «Tu» pose la question de l’altérité, et reconnait déjà une part d’existence. Ce processus m’a pris des années, mais je dirais qu’à partir du moment où j’ai demandé «Dieu existes-Tu», la question était réglée, même s’il m’a fallu des semaines supplémentaires pour m’en rendre compte.
Vous osez proclamer votre conversion, tout en refusant le spectaculaire d’une route vers Damas, mais en insistant sur les transformations profondes à l’intérieur de vous-même. Peut-on la résumer avec des mots à nuance pascalienne, ceux-là mêmes que vous notez vers la fin de votre livre : «Je ne me bats plus, je me rends» ?
Il m’a semblé important d’être sincère, et de dire les choses telles qu’elles se sont passées. J’avoue que cette affirmation reste difficile à faire, et c’est avec peine que j’admets avoir la foi, tant la part que tient la rationalité dans mon parcours est importante. Mais je veux être le témoin que l’on peut vivre de manière assumée sa foi et demeurer dans le monde. Je n’ai pas vocation à l’érémitisme ou à me cloitrer, et je veux vivre pleinement ma vie en libre-penseur comme je l’ai toujours fait, mais avec ce bémol d’importance que je sais que vibre désormais au fond de moi quelque chose qui me dépasse, et qui ne m’appartient pas complètement. Alors oui, en ce sens, j’ai cessé de me battre contre cette évidence, et je me rends.
Où en êtes-vous aujourd’hui, après cette «croisade» d’où vous êtes revenu avec «le cadeau de Calvignac», comme vous l’appelez?
Je me sens infiniment plus léger, plus serein aussi, et empli d’une joie nouvelle dont je suis le premier surpris. Je ne fais pas de ma foi un étendard, et je garde pour moi mes convictions, même si je tente d’être plus bienveillant, plus ouvert aux autres et plus enclin à passer sur mes imperfections. Je ne suis pas meilleur qu’un autre, et je ne me sens pas grandi de ce que j’éprouve. Je suis seulement plus présent au monde, à sa beauté et plus conscient de la richesse que représente l’échange avec autrui. Bref, je me sens plus humain, et infiniment vivant.
En parlant du nom donné à Dieu, quel sens donneriez-vous après votre expérience à l’amour de Dieu dans son sens plus précis d’agapé, d’amour inconditionnel et de don de soi ?
C’est un amour bien particulier, d’une qualité rare, bien sûr, mais qui a cela de particulier qu’il ne se donne à sentir que dans l’abandon, et que l’on ne peut éprouver, je crois, qu’après avoir renoncé à être quelqu’un d’autre que soi. Il faut revenir aux fondamentaux, à savoir une connaissance aiguisée de qui l’on est pour pouvoir s’abandonner à l’amour de cet incommensurable. Il n’y a pas de crainte à avoir, car on ne laisse rien de qui l’on est sur le bord du chemin. Au contraire, c’est parce que l’on est en harmonie avec soi-même que l’on peut se tourner avec confiance vers la Transcendance. En tout cas, c’est ce parcours spirituel qui m’a conduit à retrouver la foi, chemin vers la vérité de moi-même pour atteindre Dieu.
Interview réalisée par Dan Burcea
Crédits photo : Gérard Rondeau
Guillaume de Fonclare, Ce nom qu’à Dieu ils donnent, Éditions Stock, 2019, 272 p., 17,50 euros.

